The young world





- Patrick Isabelle n'a pas vraiment aimé ce livre
- Partager ce billet



- Fiche technique
- Titre : The Young World
- Auteur : Chris Weitz
- ISBN : 9782702440117
- Éditeur : Éditions du Masque
- Année de publication : 2015
- Nombre de pages : 378 pages
- Niveau de difficulté : intermédiaire
- Public cible : 15 ans et plus
- Genre : Dystopie
- Mots-clés : Post-apocalypse, suspens





Billet écrit par Patrick Isabelle, auteur et libraire
Dans un futur pas très lointain, un virus décime toute la population des États-Unis, n’épargnant que les adolescents. Ceux-ci se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans eau, sans électricité, sans repère. Dans l’immense ville de New York, plusieurs d’entre eux formeront des clans afin de survivre et de se protéger des autres. Mais la paix est fragile et personne n’est à l’abri puisque, aussitôt arrivé à leur dix-huit ans, le virus les rattrape et ils meurent à leur tour.
Au sein de la tribu de Washington Square, c’est Jefferson qui est le leader. Intellectuel et philosophe, il partira avec quatre autres ados à la recherche de l’origine du virus et d’un possible remède qui, selon les rumeurs, existe quelque part dans la ville. Parmi eux, Donna dont il est secrètement amoureux. Ensemble, il devront affronter les dangers de ce nouveau monde, violent et précaire, où chacun tente de survivre à sa manière.
Ce roman dystopique nous transporte encore une fois dans un monde postapocalyptique où les adolescents doivent faire face à l’adversité tout en contrôlant les hormones qui leur font oublier l’urgence de la situation. Ce récit s’adresse définitivement à un public adolescent par les thèmes qu’il aborde (violence gratuite, sexualité) tout en gardant un niveau de lecture intermédiaire. La pauvreté du vocabulaire et les phrases simples rendent la lecture facile et s’avèrent efficaces pour garder le lecteur en haleine.
Mon avis
J’étais curieux de me plonger dans ce roman parce que, disons-le franchement, il s’agit ici d’une idée mainte et mainte fois reprise depuis la parution de Sa majesté des Mouches de William Golding (Je pense entre autres à Gone de Micheal Grant ou encore à Ennemis de Charles Higson). L’impression de déjà-vu était déjà là, mais comme l’auteur est d’abord et avant tout un réalisateur de renom (Twilight, The Golden Compass, American Pie, About a boy), j’avais bon espoir qu’il réussirait à apporter un souffle nouveau au genre. Première déception.
De cliché en cliché, nous suivons à la fois deux narrateurs : Jefferson et Donna. Ce premier, malgré tous les efforts de l’auteur, n’est tout simplement pas crédible. Il analyse tout avec un recul qui ne se prête pas au genre de récit auquel nous avons droit et s’adresse directement au lecteur avec une lucidité déconcertante. Donna, de son côté, est insupportable… à mon humble avis, bien sûr. D’entrée de jeu, elle nous avoue ne pas être belle, ce qui m’apparaît plutôt futile comme inquiétude quand tes jours sont comptés. Ses réflexions sont généralement vides et, malgré le fait qu’elle pose un autre regard sur différentes scènes du roman, elle n’apporte rien au récit, à part peut-être le côté romance auquel on s’attend depuis les premières pages. Aucune surprise ici.
Le rythme du roman est tout de même soutenu et l’intrigue est intéressante. Mais c’est bien la seule force de ce premier roman qui manque de profondeur. Les personnages sont hautement stéréotypés et les situations dans lesquelles ils se retrouvent n’ont rien de nouveau. Je pouvais facilement deviner la suite des choses, comme si Chris Weitz avait pris le meilleur des dystopies sur le marché et en avait fait un grossier collage. Mélangez à ça une touche de romance à la Twilight et vous avez The Young World.
J’ai terminé le roman, pour le bien de cette critique… mais en temps normal, j’aurais abandonné à la moitié. J’avais encore espoir d’être surpris, mais je suis arrivé à la fin pour découvrir que c’était le premier tome d’une trilogie et que je n’apprendrais rien de plus sur ce « fameux » virus. Dommage.
Vous avez aimé le billet ? Procurez-vous le livre…
Sophielit est partenaire des Librairies indépendantes du Québec (LIQ). Cliquez ici pour plus d'informations sur ce partenariat.
Si vous avez aimé, vous pourriez être tenté par...
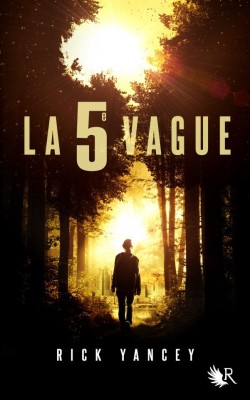
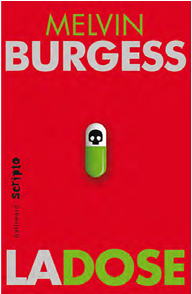

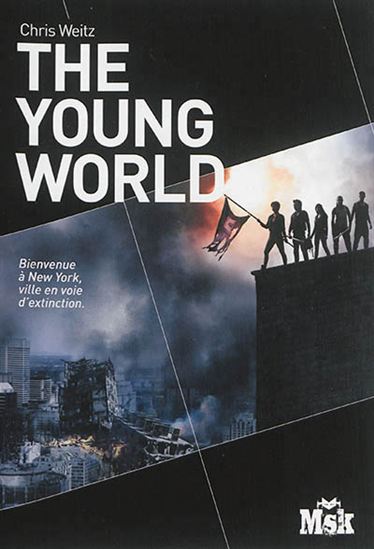





Nouveau commentaire